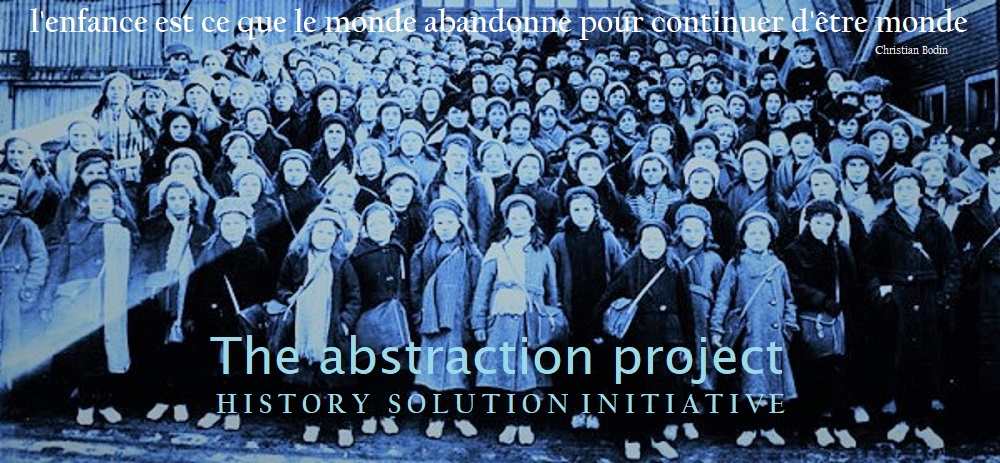Dans son livre L’Esprit de l’athéisme (Albin Michel, 2006), André Comte-Sponville a consacré quelques pages au problème du mal (Si Dieu est tout-puissant et infiniment bon et s’il a créé le monde, pourquoi le mal ?). Un de mes correspondants s’est étonné que ce qu’il appelle mon « fameux » argument sur « la souffrance des enfants comme mal absolu » (Orientation philosophique, chap. 1) ait été ignoré. Je lui ai donné l’explication de cette omission. C’est cette explication que je veux répéter ici. Comte-Sponville fait la somme de tous les maux du monde. Il y a les maladies. Il ne dit pas seulement « le cancer » ; il ajoute une douzaine d’autres maladies. Il y a les phénomènes dévastateurs. Il ne cite pas seulement les séismes ; il ajoute les raz de marée, les ouragans, les inondations, les éruptions volcaniques. À la souffrance humaine, il ajoute la souffrance animale, et conclut : « La douleur est innombrable, le malheur est innombrable » (p. 127).
Or, Voltaire s’en était tenu au seul tremblement de terre de Lisbonne, car un seul exemple d’horreur suffit. Quant à moi, je ne considère même pas la totalité du tremblement de terre, mais le seul exemple d’un enfant écrasé sous sa maison et qui agonise. Dostoïevski fait de même. Il y a une multitude de souffrances, dit-il par la voix d’Ivan Karamazov, mais « je ne m’arrête qu’aux enfants, car ce que j’ai à dire acquiert, en ce cas, une clarté irréfutable » (Les Frères Karamazov, trad. Boris de Schloezer, Stock, p. 341). Que ce ne soit pas là la seule pensée du héros du roman, mais celle de Dostoïevski lui-même, il le confirme dans une lettre du 10 mai 1879 : mon héros « a choisi, à mon avis, un thème irréfutable » (cité par Nina Gourfinkel, Dostoïevski, notre contemporain, Calmann-Lévy, 1961, p. 265).
Au lycée d’Évreux, en 1956, j’ai lu à mes élèves – Marie-Noële s’en souvient – le passage suivant des Frères Karamazov. On est au début du XIXe siècle. Un général vit dans sa propriété, parmi ses deux mille serfs. Voici qu’un jour un petit garçon d’une huitaine d’années, le fils d’un serf, blessa à la patte, en jouant avec une pierre, le chien favori du seigneur. “Pourquoi mon chien boite-t-il ?” On lui explique la chose. “Ah ! c’est toi, dit le général en examinant l’enfant. Saisissez-le.” On le prit à sa mère, et il passa la nuit au cachot. Le lendemain, dès l’aube, le général part pour la chasse en grande cérémonie au milieu de ses parasites, de ses piqueurs ; tout le monde est à cheval. Toute la domesticité est rassemblée pour faire un exemple, et au premier rang on place la mère du coupable. Celui-ci est amené de sa cellule. La journée d’automne, froide et brumeuse, s’annonce excellente pour la chasse. Le général fait déshabiller l’enfant ; il est tout nu, tremblant de froid, presque fou de terreur, n’osant dire un mot. “Faites-le courir”, ordonne le général. “Cours, cours !” crient les piqueurs. Le gamin se met à courir… “Taïaut !” hurle le général, et il lance sur l’enfant toute la meute. Les chiens déchirèrent l’enfant sous les yeux de sa mère… Le général fut mis en tutelle, je crois. (p. 338-339) Il s’agit ici d’un fait réel. Cependant Dostoïevski est un romancier. Il décrit la souffrance de l’enfant (voir, par exemple, en appendice des Possédés, la terrible « Confession de Stavroguine », presque insupportable à lire), il ne la conceptualise pas.
Mais pour argumenter, il faut conceptualiser. De là la notion que j’ai mise en avant, de mal « absolu », c’est-à-dire injustifiable « à quelque point de vue que l’on se place » (cela dès 1958, dans un article de la Revue de l’enseignement philosophique). En énumérant les douleurs et malheurs du monde, A.C.-S. produit un effet. Il est le conférencier qui subjugue les auditeurs. Il y a le cancer, la myopathie, la mucoviscidose… Soit ! Et alors ? Qu’y a-t-il là de concluant contre Dieu ? Il faudrait l’expliquer. Car on a le défilé de tous ceux, théologiens et philosophes, qui nous disent : il n’y a rien là de concluant contre Dieu. Dans l’Orientation philosophique, j’ai passé en revue les explications du mal de souffrance que nous donnent les avocats de Dieu – Leibniz, Malebranche, Jaquelot, le R.P. Petit, Max Scheler, le P. Sertillange, etc. Je les ai traitées avec une ironie plutôt grinçante. Dostoïevski consent à ne pas tirer parti des souffrances d’adultes. Les avocats de Dieu ont trop beau jeu puisque les adultes sont pécheurs : « Je ne parle pas des souffrances des adultes ; ceux-là ont mangé la pomme… mais les enfants ! les enfants ! » (p. 338).
De mon côté, j’explique : Pourquoi privilégier les souffrances des enfants ? Les adultes n’en connaissent-ils pas d’aussi atroces ? Il y a cependant une différence radicale. C’est que, par l’attitude qu’il adopte envers elle, l’adulte tient sa souffrance à distance. Il “crâne” devant la douleur (“orgueil, contrepesant toutes les misères”, dit Pascal, fr. 405 Br.) ou la “supporte” patiemment, la “subit” en révolté, “s’y abandonne” avec désespoir, la nargue, s’en “détache”, l’“accepte” avec joie. Il dispose en un mot d’un éventail d’attitudes possibles […]. Mais considérons l’enfant. Ici, la douleur frappe de plein fouet. Dépourvu des recours que donnent l’orgueil, la haine, l’intelligence, la foi, lui seul est totalement exposé à la douleur. Il ne s’y abandonne pas, il lui est livré, abandonné. (Orientation philosophique, p. 41-42) Saint Augustin écrit à saint Jérôme : « Quand on en vient aux peines des enfants, je suis, je l’avoue, dans un grand embarras et je ne sais que répondre. Ne sont-ils pas abattus par les maladies, déchirés par les douleurs, torturés par la faim et la soif, affaiblis dans leurs membres, privés de l’usage de leurs sens, tourmentés par les esprits immondes ?… » (Œuvres complètes, éd. L. Vivès, Paris, 1869-1878, t. V, p. 461).
Oui, la souffrance des enfants martyrisés – que ce soit par la nature ou par les hommes – est un mal absolu, exorbitant à toute justification et qui suffit à rendre impossible une théodicée quelconque. C’est là un argument dont le poids est si décisif qu’il a valeur de preuve – ce qui s’entend, certes (comme l’indiquent les mots « argument », « preuve »), au plan rationnel. J’argumente donc à partir de la seule souffrance des enfants (sans nier, bien sûr, toutes les autres !). C’est là, ai-je dit, reprenant l’expression de Descartes, mon « point d’Archimède », qui suffit à faire basculer l’explication théologique du monde. A.C.-S. sait cela : n’a-t-il pas préfacé mon Orientation philosophique ? Mais ma méthode et ma façon d’argumenter sont si différentes des siennes, qu’il ne pouvait leur faire une place dans son discours sans en compromettre le caractère et l’économie générale. L’omission qui a étonné mon correspondant a donc sa raison d’être.
LXXV. Mal absolu
« Noms. Journal étrange III »
par Marcel Conche.